
|

|
|
Histoire de la Vendée du Bas Poitou en France |
||
|
|
||
| Chapitre Précédent | Table des matières | Chapitre Suivant |
|
LA FÉODALITÉ EN VENDÉE DE 877 à 1180
|
|
|
A partir du règne de Charles le Chauve, il n'y eut plus d'intérêts généraux, plus de gouvernement national. L'assemblée de Kersi-sur-Oise, ayant, en 877, rendu héréditaires des fiefs concédés jusque là à titre temporaire, la puissance des rois devint illusoire. Comme on voyait briller partout le fer destructeur des Normands, et qu'il n'existait plus ni force centrale, ni corps d'armée qui pût arrêter, ce torrent, tout propriétaire fut forcé de veiller à sa propre défense, afin de . ne chercher son salut que, dans son courage (1). Le Poitou surtout, fut ainsi pendant plus d'un siècle, abandonné à ses propres forces ; les populations s'habituèrent alors à ne plus compter que sur leurs ducs et comtes, devenus héréditaires et véritables souverains du pays. Chaque seigneur bravant utilement les défenses faites par Charles le Chauve, fortifia son château, et mit sa famille et ses biens à l'abri de la surprise et du péril. La menace, continuelle du danger précipita surtout le mouvement de concentration de la propriété foncière (2), et rendit plus nécessaires les liens qui s'établirent entre la faiblesse et la force pour la défense commune. L'excès des malheurs et des périls ramena tous les intérêts les plus opposés au soin du salut commun, et la plus impérieuse des lois, la nécessité, fit alors naître de ce chaos un nouvel ordre de choses qui est devenu la féodalité. Nous dirons peu de choses de ce régime, qui en Vendée fut constitué d'une manière plus forte et plus indépendante rendit de grands services à son origine, et donna lieu plus tard à des abus de tous genres. |
|
|
NOTES: (1) On attribue assez généralement à ces premières résistances de la noblesse contre le souverain, l'origine de cette chevalerie errante (A) qui a ses pages si pittoresques dans les mœurs du moyen âge. Les manoirs étaient souvent dés refuges, où un chevalier admettait à une hospitalité généreuse, le voyageur qui regagnait sa patrie, le pèlerin, le, marchand lui-méme. (A) La chevalerie était proprement, de nom comme de fait, la milice d'élite de la France dont il est déjà fait mention dans un des capitulaires de Charlemagne (807), l'armée du' château féodal. (2) Cette concentration fut encore dans le même temps favorisée par l'établissement du droit d'aînesse, qui n'existait pas dans la loi germanique. - La loi salique appelait tous les enfants mâles au partage égal de la terre, dans les successions, et assurait même une part aux enfants illégitimes ; les filles seules étaient esclaves avec une rigueur exagérée, que l'usage avait fait disparaître.
|
|
|
RELÈVEMENT DES ÉGLISES. - CHÂTEAUX FÉODAUX
|
|
|
A la fin du Xe siècle, les églises et les monastères du Poitou se relèvent de toutes parts : toutes les classes de la population réunissent leurs premiers ' efforts pour rebâtir les temples de Dieu et faire disparaître les ruines des abbayes ; mais à côté du clocher qui s'élance de nouveau vers le ciel, près du monastère qui répare ses murailles renversées, et de l'ancien village gallo-romain qui commence à reconstruire ses maisons de bois brûlées par les Normands, nous trouvons la tour féodale qui a résisté aux attaques des pirates. A l'abri de ses fortes murailles, habite le possesseur d'un grand fief devenu héréditaire il est là avec sa famille, au milieu des tenanciers qui cultivent sa terre, entouré, de vassaux, possesseurs d'anciens fiefs qui lui doivent foi et hommage, et le service de leur épée au jour du combat. Plus d'une fois, à l'approche des Normands, l'enceinte fortifiée à servi de refuge aux populations : le seigneur féodal est sorti avec ses hommes d'armes, et a repoussé loin de la contrée, le pillage et l'incendie ; trop heureux, lorsqu'il ne se servait pas quelquefois lui-même de sa puissance pour molester plus faible que lui, ainsi qu'en témoigne le fait suivant. |
|
|
NOTES: (1) Cette concentration fut encore dans le même temps favorisée par l'établissement du droit d'aînesse, qui n'existait pas dans la loi germanique. - La loi salique appelait tous les enfants mâles au partage égal de la terre, dans les successions, et assurait même une part aux enfants illégitimes ; les filles seules étaient esclaves avec une rigueur exagérée, que l'usage avait fait disparaître.
|
|
|
LES PIRATES DE NOIRMOUTIER VERS 1060
|
|
|
Au premier âge de la féodalité vouée au régime de la force, moins encore par son principe et sa nature, que par le milieu et les circonstances dans lesquelles elle se développa, presque tous les seigneurs étaient devenus,, suivant le mot énergique d'un chroniqueur (Orderic Vital) " brigands, ennemis des voyageurs et des faibles ". Plusieurs chartes de cette époque prouvent en particulier que ceux, de nos côtes tiraient d'une active piraterie, la source la plus claire et la plus abondante de leurs revenus. Celle dont on va lire la traduction appartient au Cartulaire de l'abbaye de Saint-Sauveur-de-Redon, en Bretagne. Cet acte est la convention faite par le seigneur Perenès (1), abbé de Saint-Sauveur, et de ses moines, avec Gautier et Gosselin hommes nobles, seigneurs des châteaux de la Garnache, de Beauvoir et de Noirmoutier. Car il arriva que les susdits nobles, ayant suivi un vaisseau des moines allant en Poitou, s'en emparèrent à son retour et le pillèrent complètement. Dans la suite, repentants de cette faute, ils rendirent à deux moines de ce monastère, Merkiou et Gautier, tout ce qu'ils avaient pris. Voulant, en outre. obtenir d'être associés au bénéfice des prières de tous les frères, ils concédèrent à perpétuité, eux, leurs femmes, leur fils et leur postérité, l'exemption de tous droits, cens et seigneuries, pour deux navires des moines de Saint-Sauveur. Les témoins suivants ont corroboré la puissance de cetteconvention : Gautier, lui-même, et Gosselin Pierre, fils de Gosselin ; Guillaume, moine de Saint-Jouin ; Hermenfroy, moine de Saint-Martin; Gosselin, de Palluau; Airard, de Noirmoutier ; Aimery, son fils ; Albéric, de la Garnache ; Boson, de Beauvoir ; Albois, le fils d'Armand ; Béranger, fils de Gautier ; Aimery, sénéchal; Gobin; Haton, prévôt; Monz (2). |
|
|
NOTES: (1) Mourut en 1060. (2) Recherches historiques sur le département de la Vendée, par feu de la Boutetiére.
|
|
|
OBLIGATIONS MILITAIRES DES BAS-POITEVINS
|
|
|
Le comte du Poitou gouvernait comme partout la force militaire de son territoire ; mais, contrairement à ce qui se passait ailleurs, les Poitevins n'étaient tenus qu'à trois mois de service, et c'était peut-être là une de ces immunités déjà fort anciennes, qu'avait signalées le poète Claudien. Au reste, le recrutement n'appelait que les hommes libres, c'est-à-dire ceux qui possédaient quatre manses, ou habitations rurales, contenant chacune une valeur d'à peu près dix arpents (1). Pour maintenir les soldats sous les drapeaux, au-delà le terme de trois mois, il fallait une prolongation de la guerre ; mais alors, comme le service de ce que l'on appelle aujourd'hui l'intendance, n'était pas encore inventé, l'armée vivait dans le pays occupé, entière-ment aux frais des populations qui, souvent, étaient ruinées pour longtemps. C'étaient donc les leudes, les vassaux et arrière-vassaux qui effectuaient les réunions armées sur un point donné du territoire. Là se rendaient, au premier appel, comme nous l'avons vu pour Fontenay-le-Comte, en 841, les hommes libres qui recevaient les ordres immédiats du comte. Antérieurement à l'époque féodale, c'était le roi seul qui avait le droit de convoquer les seigneurs de tout rang qui étaient ses hommes liges. Mais tout fait croire qu'à l'époque où nous voilà parvenus, le vieil esprit d'opposition à la monarchie d'outre-Loire, s'étant toujours maintenu, le comte avait déjà acquis une assez grande indépendance de la couronne, pour que les leudes ne voulussent obéir qu'à lui seul. C'est donc sous sa bannière que les Poitevins s'en allèrent, dans la Neustrie, guerroyer contre les Normands (2). |
|
|
NOTES: (1) Ducange (V. Mansum) Guérard. -Prolégomènes du Polyptique d'Iminon, page 378 (2) Auber. - T. VI, pages 47 et 48. - C'est au commencement du x' siècle, vers 927, que la vicomtesse d'Aunis, Senégonde, donna à l'abbaye de Saint-Maixent, cent-huit ares de marais salants, situés près de la Rochelle.
|
|
|
LES PREMIERS CHATEAUX FORTS
DE VENDÉE ET LES
|
|
|
En peu d'années, le Bas-Poitou, naguère sans défense, vit ses coites Hérissées de forteresses, les murs de ses cités garnis de tours, les villages bien armés, chaque éminence protégée par un château défendu par un fort, et la terre peuplée de cultivateurs soldats. Alors s'élevèrent, pour être remplacées ou complétées ultérieurement par d'autres plus formidables, les_ forteresses de Moricq, Beauvoir, La Garnache, Noirmoutier, Fontenay, Maillerais, Mareuil-sur-le-Lay, Apremont, Palluau, Puymau frais, Mortagne, Mervent, Tiffauges, Pouzauges, Bazo-ges-en-Pareds, La Roche-sur- l'on (1), Talmont, Châteaumur, etc. Les monastères eux-mêmes, Noirmoutier, Saint-Michel-en-l'Herm, devenaient des forteresses. Les plus simples églises se crénelaient dans les campagnes, s'entouraient de murs épais, afin d'offrir un asile, soit; aux laboureurs de la contrée, qui venaient s'y abriter au besoin avec leurs femmes, leurs enfants et leurs troupeaux, soit à des hommes d'armes qui s'en faisaient les défenseurs en y tenant garnison. Cet usage se conserva longtemps, et les églises du Boupère ,de Saint-Juire-Champgillon, de Réaumur, et l'ancienne chapelle d'Ardennes, près Charzais, nous rappellent encore ces temps d'insécurité et de violence, où le salut ne résidait que dans là force. 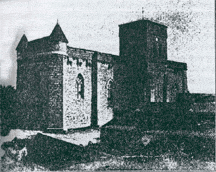 Eglise fortifiée du Boupère, d'après un cliché de M. Bonneau. Depuis ce moment, les Normands cessèrent peu à peu de trouver, dans le Bas-Poitou, une proie, facile ; et s'ils lui firent encore de cruelles blessures, ils y rencontrèrent au moins, à chaque pas, des guerriers, des périls et des combats. |
|
|
NOTES: (1) Il y existait une église et un château dès le milieu du Xe siècle.
|
|
|
LES CHATEAUX-FORTS BAS-POITEVINS
AUX XIe, XIIe
|
|
|
Vers le XIe siècle, les châteaux-forts du Bas-Poitou se composaient souvent de trois enceintes, dont la configuration se rapprochait le plus possible de la forme rcctangulaire, bien que cette forme reçut fréquemment de notables modifications en raison de la disposition du terrain, dont on devait tenir compte avant tout. Le terrain enclos par les remparts était appelé la Basse-cour; c'est là que se trouvaient les magasins, les écuries, le saloir, le lardoir, les logements; des maîtres du château et. de la garnison, un puits ou une citerne, et enfin une chapelle, tantôt formant un édifice à part, tantôt ménagée dans une tour. Le donjon en pierres de taille, rond ou carré, était divisé en trois ou quatre étages, et portait à une certaine hauteur, des corbeaux rustiques, sur lesquels on établissait des balcons en planches ; plus tard ce balcon fut construit en pierre. Il faut remarquer que c'est presque toujours par des ouvertures pratiquées au deuxième étage qu'on pénétrait dans le donjon. Les murs étaient soutenus par des contreforts carrés, et les donjons se terminaient à leur partie supérieure par une terrasse ou par un toit à quatre pans; jusqu'au XIe siècle, une des tours d'enceinte servait habituellement de donjon. Au ne siècle, la manière de bâtir devient plus élégante et plus solide. Les tours sont garnies d'une galerie de mâchicoulis en pierre, surmontée de créneaux. Les donjons carrés étaient flanqués à leurs angles supérieurs de guérites à vigie en encorbellement. La première enceinte contenait des bâtiments qu'on utilisait de diverses façons; la seconde renfermait le donjon et l'habitation du baron. Dans la dernière moitié du XIIe siècle, les tours rondes devinrent les plus communes, et les baies affectèrent la forme d'arcs en tiers-point. A partir du XIIIe siècle, la France féodale était constituée, le réseau de forteresses était complet, et on éleva peu de châteaux. L'architecture militaire de cette époque présente les mêmes caractères que l'architecture religieuse que nous avons étudiée. Les salles d'habitation prirent un développement considérable et furent décorées de vitraux et de peintures. Dans les constructions importantes, le donjon renferme une autre tour encore plus importante, appelée maîtresse-lotir, belfroy, beffroi, parce qu'elle contient la cloche d'alarme. Il arrive aussi que les donjons n'ont pas de porte au rez-de-chaussée : dans ce cas on y entrait par une fenêtre assez élevée, qu'on atteignait avec une échelle ou au moyen d'un pont manoeuvré par une poulie. |
|
|
|
|
|
Le château de Pouzauges, édifié vers, la fin du XIIe ou vers le commencement du XIIIe siècle, peut passer pour un des principaux types d'architecture militaire en Bas-Poitou. Il se compose d'un donjon et d'une forte enceinte de murailles, dont l'épaisseur, en quelques points, atteint près de deux mètres. 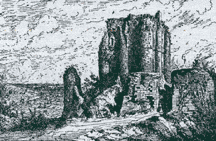 DONJON DU CHATEAU DE POUZAUGES XI D'après une eau-forte de M. de Rochebrune Ces murailles, renforcées de tours, dont dix étaient encore parfaitement reconnaissables il y a quarante ans, se trouvaient défendues par des fossés d'une largeur et d'une profondeur' énormes. Une autre enceinte, complètement détruite aujourd'hui, protégeait toute la partie de la seconde enceinte qui n'était pas baignée par l'eau des douves. Ce donjon, de forme carrée, possède trois étages voûtés. Ses côtés, de 18 m 40 de largeur, sont flanqués aux angles et au milieu, de tourelles pleines, aplaties sur les faces. Le premier étage, partiellement situé en contre-bas du sol, ne présente d'autre ouverture qu'une porte. Privé de cheminée, il devait servir de magasin. Le second renfermait la grande salle du château, éclairée par une fenêtre carrée de petite dimension et pourvue d'une porte étroite très élevée au-dessus de la base de l'édifice. Une grande cheminée permettait de Chauffer cette pièce, qui était la plus belle et la moins triste du sombre manoir. A côté se trouve une salle complètement obscure. Au troisième, deux grandes chambres à coucher reçoivent le jour par deux ouvertures carrées. Enfin l'édifice, à la partie supérieure duquel on accédait jadis par un escalier en colimaçon, était recouvert d'une plate-forme qu'environnait un chemin de ronde, protégé par un parapet soutenu par des mâchicoulis. La grosse tour qui défend l'angle le plus aigu de l'enceinte
principale s'appelle encore Tour de Bretagne. Elle pourrait bien être
l'oeuvre de Gilles de Rais, dont le terrifiant souvenir plane encore
ici comme à Tiffauges. Une de ses meurtrières semble de
toute évidence avoir été construite pour l'emploi
de l'artillerie la pénétration que, l'on remarque de chaque
côté était, sans nul doute, destinée à
recevoir la traverse sur laquelle devait s'appuyer la couleuvrine et
plus tard l'arquebuse. Un porte-voix, comme à Tiffauges, servait
à transmettre les commandements autour des courtines, dans toute
la circonférence de l'enceinte et autour de la salle du troisième
étage du donjon. Son diamètre intérieur était
de 0 m. 20. Quant à-la paroi intérieure, elle était
enduite de mortier à la chaux. 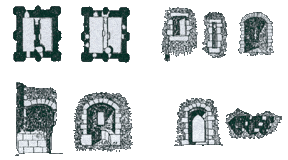 Plans et coupes du vieux donjon de Pouzauges vieux donjon de Pouzauges Rien ne peut rendre l'aspect de cette solitaire et puissante forteresse, avec ses murs noircis et déchirés par le temps, où l'oeil découvre à peine les jours qui étaient si parcimonieusement ménagés aux habitants de cette féodale demeure. Véritable nid d'aigle, tout y a été combiné pour la défense, rien ménagé pour le plaisir des yeux. Une simple visite à cet antique témoin d'une époque qui n'est plus, en dit davantage sur- la vie privée du moyen âge, que toutes les descriptions, et on ne peut songer sans effroi aux guerres épouvantables qui obligeaient de riches et puissants seigneurs i venir s'emprisonner, avec leur famille, dans une telle résidence
|
|
|
V. - CANTON DE TALMONT
|
|
|
Talmont, aujourd'hui simple chef-lieu de canton, fut jadis la, capitale d'un des grands fiefs du comté de Poitou, embrassant toute la région comprise entre le cours inférieur du Lay et celui de l'Yon et du Jaunay, et les côtes de l'Océan. Les ruines du château, bâti au commencement du Xle siècle, disent encore quelles dut être son importance : elle est attestée d'ailleurs par tous les documents du moyen âge, rappelant le rôle joué dans notre histoire provinciale par les familles qui l'ont possédé successivement, de Talmont, de Lezay, de Mauléon et, enfin des vicomtes de Thouars. Il fut rasé en 1628 (1), en même temps que les fortifications de la Rochelle, après que cette dernière ville eût succombé sous les coups de Richelieu. De tous les événements de l'histoire de Talmont, le plus important sans contredit était resté dans l'ombre jusqu'à ces derniers jours ; il vient d'être trouvé par M. Jules Lair, dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale (3), fragment inédit de la vie de Louis VII, préparée par le célèbre Suger, abbé de Saint-Denis. Ce savant; s'est empressé de publier sa précieuse découverte (4) mais- l'un des épisodes qu'elle renferme est si intéressant pour le Bas-Poitou, que nous, n'hésitons pas à en donner ici la traduction littérale, d'après M. Marchegay. " Suger, après avoir raconté les débuts
difficiles du règne de Louis VII et les circonstances d'une insurrection
de Poitiers, qui s'était érigée en commune, en
1138, mais fut soumise aussitôt par le jeune monarque, continue
en ces termes. |
|
|
NOTES: (1) Louis Brochet. - Huit jours dans la région de la Châtaigneraie et de Pouzauges. - Léon Arde. - Annuaire 1854. (2) Dans un mémoire rédigé en 1661 par Marie de la Tour, et publié par M. imbert. T. XXXII de la Soc. des Ant. de l'Ouest, la duchesse de la Trémoille dit: " Le 8 avril 1634, j'obtins un arrêt du Conseil, qui nous adjugea une somme de 50.000 livres, pour nous dédommager du razement du château de Talmont, fait en 1628. " (3) Fonds latin, n°s 12, 720. (4) Voir Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, année 1873, pages 583-596. (5) Ce jeu de mots disparaît' en français. D'autres étymologistes voient dans Talmont, .le nom de son possesseur nomen viri, proprium Talemudus. (Ad. de Valois, notitia Galliarum, p. 577) ;d'autres le font venir de deux mots celtiques, Tal, hauteur, Mon, courbure de rivière. (D. Fonteneau, t. LXXV, page 507). (6) Père d'Eléonore, qui, par son mariage avec Louis VII, lui avait apporté les duché d'Aquitaine et comté de Poitou. (7) Charles le Simple, en 923 (8) Le Cartulaire de Talmont, page 162, raconte ainsi ce fait qu'il place en 1127. Comme un jour, au commencement de son règne, le comte Guillaume, fils du comte Guillaume le Grand, quittait le château de Talmont, où il était venu la veille, Guillaume de Lezay s'empara de Hugues le Brun de Lusignan et de quelques autres barons de la compagnie du Comte, et, eut l'audace de vouloir les retenir longtemps captifs. (9) Louis VI[ avait alors environ 17 ans (10) Recherches historiques sur l'ancien Bas-Poitou, par Paul Ma chegay - Annuaire 1874.
|
|
|
LE MOYEN AGE, SES FAIBLESSES ET SES GRANDEURS
|
|
|
Avec les Capétiens, la royauté cessa d'être une imitation de l'empire romain, comme sous les deux premières races. Elle prit un caractère national, occupa le rang le plus élevé dans la hiérarchie féodale, et trouva sa force dans l'hérédité,. par ordre de primogéniture, et dans la suzeraineté, ce précieux lien qui, partant du plus humble vassal, vint aboutir au roi, le premier des suzerains (1). Le moyen âge ne fut pas non plus, en Vendée, exempt des tristes taches qui se retrouvent dans l'histoire de toutes les sociétés modernes humaines : il eut la rudesse et les violences de la jeunesse, et trop souvent l'abus de la force y fit plier momentanément les règles les mieux établies. Mais, à côté des grandes fautes, se montrent l'expiation et le repentir, le dévouement, l'héroïsme et la foi profonde. Si dans cette organisation sociale, quelques parties se ressentent encore de l'inexpérience et de la barbarie des temps primitifs, il y a du moins dans l'ensemble une vie puissante, une grandeur qui n'a jamais eu d'égale, et le développement des immortels principes du christianisme. Ce qui frappe surtout dans les institutions de cette époque, c'est la variété infinie, la liberté et la sage pondération des éléments qui les composent : on voit qu'elles ne furent pas seulement l'œuvre des conquérants, mais l'heureuse alliance des Gallo-Romains et des Francs. Que serait devenue l'ancienne civilisation corrompue et épuisée, si elle ne s'était pas retrempée et rajeunie à de nouvelles sources? Mais aussi, comment les destructeurs de la puissance romaine eussent-ils pu sortir de la barbarie, s'ils n'avaient pas reçu des peuples au milieu desquels ils venaient s'établir, les règles et les traditions qui pouvaient servir de contrepoids à la sauvage indépendance des forêts de la Germanie ? Au moyen âge, les Gaulois et les Francs ne formèrent plus qu'un seul peuple, avec une puissante organisation, où chaque race avait mis son empreinte, ou toutes les idées, tous les intérêts sociaux trouvèrent leur représentation et restèrent un s dans une admirable harmonie. |
|
|
NOTES: (1) La grandeur féodale était accessible et simple : la distance courte du vassal au suzerain ; par l'enchaînement hiérarchique des fiefs, l'abîme était comblé entre le plus petit et le plus élevé des propriétaires féodaux, de degré en degré , le moindre d'entre eux se liait au roi, sans courir le risque de perdre le sentiment de sa propre dignité. (Guizot.- Essai sur l'Histoire de France.)
|
|
|
|
|
|
Si, dans le Bas-Poitou comme ailleurs, la féodalité laïque dut sa puissance territoriale à l'hérédité des bénéfices et, à la recommandation des alleux (1), l'église féodale dut surtout la sienne à l'obligation de la dîme. A côté des fiefs laïques de Talmont, de Montaigu, de la Roche-sur-Yon, de Fontenay, de la Flocelière, de Pouzauges, de Mortagne-sur-Sèvre, de la Mothe-Achard, de Mareuil, d'Apremont, de Mervent, il y eut aussi les terres d'église. Elles ont un aspect différent, selon qu'elles appartiennent à l'évêché ou à des abbayes. L'évêque de Poitiers s'est emparé surtout des domaines royaux contenus dans le territoire de sa cité : ils forment généralement une masse compacte, assez bien arrondie. Au contraire, le couvent qui s'est formé plus tard, a dû accepter des donations de toutes mains, en tout pays, et son domaine se compose ordinairement de parcelles disséminées (2). A l'époque où nous sommes rendus, les richesses des couvents tendent à s'accroître dans une plus rapide proportion que celle des évêchés (3). Les monastères de Saint-Martin-de-Ligugé, de Saint-Jouin-de-Marnes, de Saint-Maixent, de Luçon, de SaintMichel-en-l'Herm, de Maillezais même, sont plus populaires que l'église épiscopale de Poitiers. " Ils ont un plus grand renom de sainteté et une réputation miraculeuse mieux établie. Ils attirent à la vie religieuse les nobles et les non nobles amoureux de la paix et qui, en prenant le froc, y apportent leurs biens." Du reste, les moines ayant fait vœu de pauvreté, ce n'est pas à eux que s'adresse la donation : c'est à -saint Martin, c'est à saint Benoît, c'est à saint Hilaire, aux glorieux confesseurs et aux glorieux martyrs dont ils suivent la loi. D'ailleurs, l'administration des moines est plus régulière, plus paternelle, plus douce que celle des violents châtelains; aussi les serfs accourent-ils nombreux, avec leurs femmes, leurs enfants, leur bétail. Les couvents ne risquent rien à s'établir dans les solitudes, dans les forêts vierges : le désert ne tardera pas à- se peupler autour d'eux et la lande à se transformer en. bonnes terres arables. Plaider contre les moines, c'est bien chanceux ; ils traînent le baron illettré devant un tribunal d'Église qui juge en latin. Contre eux, le baron n'a d'autre ressource que la violence; or, la violence engendre le remords, et le remords est une source de libéralités (4). |
|
|
NOTES: (1) On appelait recommandation, l'acte par lequel le possesseur d'un alleu le transformait en fief sous la protection d'un seigneur. (2) Le bourg d'Oulmes avait été donné, dès 965, à, l'abbaye de Saint-Cyprien do Poitiers, par un nommé Guillaume. (3) Parmi les nombreux privilèges accordés aux abbayes, tels que l'exemption de tous péages, et le privilège de la pèche, partout on leurs navires pouvaient pénétrer, il en est un particulièrement remarquable, dont il est fait mention en 940 : c'était une autorisation, pour les religieux, de créer des bureaux de change dans leurs diverses maisons. Ce moyen de faciliter les transactions commerciales, presque uniquement dévolu aux moines, était donc connu dès le Xe siècle (Auber. - T. VI, page 216). - En octobre 934, il est question d'un complant de vignes que reçoivent de l'abbé de Saint-Maixent, Godemer et Ermangarde, hauts personnages poitevins, à condition que dans cinq ans " le plant qu'auront fait les donataires sera partagé entre eux et le donateur ". - Auber, 263. (4) Rambaud..- Histoire de la civilisation, T. i, pages 135, 136, 137.
|
|
|
|
|
|
On était alors à l'an mille, et d'affreux pressentiments alarmaient tous les esprits, sur la fin prochaine du monde et le règne de l'Antechrist. Depuis le commencement du siècle, on s'attendait à voir finir le monde. Mundi termino appropinquante disent presque tous les auteurs du temps. On avait vu l'empire de Charlemagne crouler après l'empire romain, les ruines s'entasser sur les ruines, les malheurs succéder aux malheurs. Le christianisme lui-même, semblait impuissant à guérir les maux d'ici-bas; de sorte que cette fin du monde était à la fois l'espoir et la terreur des chrétiens " Voyez ces vieilles statues, dans les cathédrales et même dans les églises romanes des Xe et e siècles, maigres, muettes et grimaçantes dans leur roideur contractée, l'air --souffrant comme la -vie, et laides comme la mort. Voyez comme elles implorent, à mains jointes, cette seconde mort de la résurrection. qui doit les faire sortir de leurs ineffables tristesses. " C'est l'image de ce pauvre monde où chacun attendait. ...Le prisonnier attendait clans le noir donjon, le serf attendait sur la-glèbe, le moine attendait au fond du cloître, entre l'ange consolateur t le diable qui tirait la nuit sa couverture, en lui disant avec un éclat de rire : " Tu es damné", le seigneur attendait entre les murs de son sombre manoir, derrière lesquels s'était souvent accompli plus d'un drame terrible. Le siècle s'écoula pourtant sans qu'on entendit le son de la trompette fatale, et chacun finit par espérer. La nature, brusquement rassurée, se sentit prise d'un élan d'espérance: partout on voulut par des monuments durables attester sa foi, encore surexcitée par des prédications. Chacun à cette époque de rénovation tint à se faire complice de ces artistes généreux, de ces imagiers qui s'intitulaient " les logeurs du bon Dieu et maîtres de l'oeuvre ", qui venaient de trouver en eux, la puissance d'expression, la vitalité de la` race, et d'affirmer le génie, si longtemps comprimés de la nature. La noblesse, pour expier ses fautes ou se sanctifier, le clergé pour exalter le culte de Dieu, prodiguent leur argent et leur influence, et le peuple ses sueurs pour élever des églises, des châteaux, des donjons, des abbayes. Depuis la chute des Carlovingiens, l'art français naît, grandit, se développe, et dans cette nuit étoilée du moyen âge " le rôle civilisateur de la France se reflète sur tous .les points du Bas-Poitou. Le XI, le XII et le commencement du XIIIe siècle furent pour la Vendée, l'époque où les grands monastères pourvus de riches donations s'élevèrent comme par enchantement mais bien antérieurement à cette date, des dons nombreux avaient été faits aux couvents par des bas-poitevins. Citons au hasard. Au mois d'août 969, Aubert, fils de Ramnulfe, donne le domaine de la Faucherie au monastère de Luçon. - En 989, Guillaume Fier-à-Bras concède à l'abbaye de Bourgeuil; le village et l'église de Longèves, ainsi que quelques maisons des Loges, des vignes situées à Fontenay et à l'Orbrie, la Court de Foussay et l'église Saint-Hilaire de, ce lieu. - En 997, Girbert Corpeau et Agnès sa femme,' donnent à l'abbaye de Maillezais divers domaines situés à Coùtigny, la Vallée-d'Or, le Bois-Roux, lés Chaumes etc. De 1019 à 1029, Guillaume le Grand, duc d'Aquitaine et comte de Poitou, donne à l'abbaye ci-dessus plusieurs domaines, entre autresla chapelle de Ruscunila, placée à Fontenay, les deux moulins construits au pied du château, divers domaines situés à Boisse, Serigné, Vouvent, Xanton, Darlais, Tesson, etc.
|
|
|
|
|
De l'an 1007 à l'an 1210, quatorze abbayes, suivant presque toutes la règle de Saint-Benoît, furent édifiées sur le sol du Bas-Poitou. Nous résumons ci-après leur histoire.
|
|
|
|
|
|
L'abbaye bénédictine de Saint-Jean-d'Orbestier, dont on voit encore les ruines dans la commune du Château-d'Olonne fut fondée en 1007, par Guillaume IV, dit le Grand, duc d'Aquitaine, comte de Poitou et seigneur de Talmont. Dans la charte de fondation, on lit qu'il y avait autour de ce couvent une forêt nommée 0rbisterium, qui avait une grande étendue. Les principaux bienfaiteurs de l'abbaye furent les ducs d'Aquitaine, Richard Coeur de Lion, roi d'Angleterre, plusieurs seigneurs de Mauléon, de Vivonne, de la Roche-sur-Yon, d'Apremont, de Montaigu, de La Mothe-Achard et les vicomtes de Thouars. Vers 1251, le monastère devint la proie des flammes et fut rebâti avec les aumônes des fidèles, d'après les exhortations de l'abbé. Plus tard il eut beaucoup à souffrir des guerres de religion, et ses bâtiments, détruits presque entièrement, ne furent relevés qu'en partie. Pendant tout le moyen âge, le nombre des religieux fut toujours assez considérable. En 1428, ils étaient dix-huit. En 1533, ils n'étaient que quatorze. Dispersés par les protestants, il n'y en avait plus que trois en 1577 (1). Enfin en 1668, le, prieur et le sacriste y résidaient seuls. La suppression de l'abbaye fut faite en faveur de la cathédrale, qui, moyennant 1200 livres de rente, s'engagea à acquitter les charges anniversaires, obits, etc. Il ne reste plus d'Orbestier qu'une maison, qui a conservé le nom de Prieuré, et les ruines de l'église, dont nous avons donné une vue dans l'histoire des guerres de religion en Bas-Poitou T. Ie page 158. En 1789, le revenu de l'abbaye était de 1.000 livres. |
|
|
NOTES: (1) On lit dans l'État du Poitou sous Louis XIV; par Dugast-Matifeux ; L'abbaye de Saint-Jean-d'Orbestier (seu orborum), destinée par le titre de sa fondation ii la retraite des enfants orphelins ; il y a trois ou quatre religieux, et vaut â l'abbé 4.000 livres et a chaque moine 5 ou 600 livres. - Extrait du Mémoire de, Colbert de Croissy au roi, 1667.
|
|
|
|
|
|
L'abbaye bénédictine de Sainte-Croix de Talmont fut fondée en 1010 (1), par Guillaume le Chauve, prince de Talmont. Son fils Guillaume, docile aux intentions de son père, approuva les donations déjà faites, et y ajouta la moitié des revenus de l'église d'Olonne. - Kalédon, qui avait épousé la coeur de Guillaume, ayant hérité de tous les biens de la famille, confirma également les dons antérieurs et y joignit l'église de Saint-Vincent-sur-Jard, celle de Saint-Hilaire-la-Forêt, celle de Saint-Nicolas-de-Grosbreuil, la dîme de ces paroisses, et l'autorisation de prendre, dans la forêt d'Orbestier, tout le bois nécessaire pour restaurer ces églises. Il ajouta plusieurs bois et terres situés près la, ville de Thouars. L'abbaye de Sainte-Croix eut fort à souffrir dés guerres de religion. Parmi les plaintes que l'évêque de Luçon portait au roi en 1565, au sujet des vexations exercées par les protestants envers les monastères et bénéfices du diocèse : " L'abbaye de Talmont, dit-il, dans laquelle on voulait avoir dix-huit ou vingt religieux, est entièrement ruinée. Depuis quatre ans, il ne s'y fait aucun service divin; les religieux ont été chassés par l'abbé apostat, nommé Boutard, et les revenus de l'abbaye ont été aliénés, dissipés et vendus (2). " Sainte-Croix de Talmont: était une abbaye royale, jouissant d'un revenu de 4.000 livres, au moment de la suppression du monastère, et de la réunion de la mense monastique à la chambre ecclésiastique de Luçon. La maison servit alors de retraite à quelques curés vieux et infirmes, auxquels on donnait une faible pension. Quelques années avant 1789, sous M. de Mercy, cette maison avait été peu à peu délaissée, et au commencement de la Révolution, il n'y résidait plus aucun prêtre .infirme. Un ecclésiastique, servant de vicaire à la paroisse,. .acquittait seule les messes d'obligation. L'abbé de Talmont avait le droit de présentation à vingt-quatre cures, dix-sept prieurés et cinq chapelles. |
|
|
NOTES: (1) Douze ans avant cette fondation, le samedi 8 juillet 1028, d'après la Chro-nique de Maillezais, une tempête violente jeta l'épouvante en' Poitou., ['11e revêtit des caractères effrayants que nul ne se souvenait' d'avoir vus. Le nord du BasPoitou, plus voisin de la Loire, fut surtout maltraité (Auber, T. vii, page 119, (2) L'abbaye de Talmont, écrivait en 1666, Colbert de Croissy au roi, où il y a quelques religieux non réformés, possédée en commende par le sieur comte de, Laval, fils de M. le duc de la Trémouille (A), vaut de revenus, en tout, 8.000 livres de rente. Etat du Poitou sous Louis XIV, par Dugast-Matifeux. (A) Louis Maurice de la Trémouilte, comte de Laval, pair de France, suivit d'abord la carrière des armes et entra ensuite dans les ordres, comme cadet de famille, tandis que son frère aîné restait protestant. Il fut à la fois abbé de Charron et de Talmont. Pourvu en. 1665 de cette seconde abbaye, il se plut à y faire sa résidence, en reconstruisit les bâtiments, et y mourut le 25 juin 1681. C'était un - homme de lettres, amateur de livres et d'objets d'art,dont il avait rassemblé une assez nombreuse collection (page 87).
|
|
|
|
|
|
L'abbaye de.Bellenoue, située dans la commune de, Château-Guibert, fut fondée antérieurement à 1047 par Gognore, fils de Geoffroy, premier vicomte de Thouars, et par Aénor, femme de ce dernier, qui se fit moine et fut inhumé à Saint-Michel-en-l'Herm, dont la nouvelle abbaye devint une dépendance. Aimeri, son fils, entouré de ses vassaux, en présence du prieur Raynault, et de divers autres témoins, confirma entre les mains de l'abbé de Saint-Michel, la donation faite par son père. La charte de fondation se trouve en entier dans le. Gallia Glaristiana. L'abbaye de Bellenoue fut dédiée à la_ Sainte-Trinité, et réduite plus tard à l'état de simple prieuré, rapportant 900 livres au XVIIe siècle. En 1719, de Cornillon Saint-Verge résidait dans la maison appelée encore La Cure, située au sud de Bellenoue, sur le chemin qui conduit à. la Série. Sur la porte extérieure de la cure, on lisait encore- en 1845, cette inscription C. Servant hujusce loci rector cedem cedificandam curavit, rappelant
ainsi le nom de Servant Charles, curé inhumé dans l'église
de la Trinité de Bellenoue, le 15 janvier 1671: En 1778, le prieur qui était curé primitif du lieu, tirait de ce bénéfice 1.500 livres de revenu. Le 20 avril 1305, mardi de Pâques, Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux, visita le prieuré de Bellenoue, et " y coucha avec son train, puis le lendemain 21 prêcha et fit, autres actes de visite ".
|
|
|
|
|
|
L'abbaye de Nieuil-sur-l'Autise (ordre de saint Augustin), fut fondée sous le vocable de saint Vincent en 1069, par Airauld Gassedener ou plutôt Cassedener (Casse denier), seigneur de Vouvent. La motte gauloise de Nieuil (najogilum), était alors devenue le centre d'un fief appelé la Court de Nieuil, dont fut investi le nouveau monastère (Besly). Gui Geofroy, duc d'Aquitaine, confirma en 1076, les dons faits par le fondateur. Les successeurs de ce prince augmentèrent encore le nombre de ces libéralités. Aénor de Châtellerauld, épouse de Guillaume- X, vint mourir dans l'abbaye, et voulut que sa dépouille mortelle reposât dans l'église du lieu ; la reine Aliénor, sa fille, s'y rendit en 1141, et ne se montra pas moins généreuse que ses ancêtres. Louis VII se hâta de s'associer à l'acte de munificence de sa femme., - Les Chabot, devenus seigneurs de Vouvent, suivirent le même exemple ainsi que les Parthenay l'Archevesque, qui leur succédèrent dans la possession de cet important domaine. Les religieux de Nieul employèrent les richesses qu'ils tenaient de leurs bienfaiteurs à édifier l'une des plus belles églises romanes du Bas-Poitou. Elle existe à peu près intacte de nos jours, pet les parties absentes n'empêchent pas de juger de son ensemble. Cette abbaye étendait sa juridiction sur de nombreux prieurés, cures et chapelles des diocèses de La Rochelle, Luçon, Poitiers, Saintes, Maillezais et Nantes. C'est sous l'administration de Balthazar de la Vrillière, c'est-à-dire à la fin du XVne siècle, que l'on résolut de faire disparaître le monastère de Nieuil, dont les bâtiments étaient dans le plus mauvais état. Enfin, par sentence de fulmination des 8 et I-t août 1718, enregistrée suivant arrêt du parlement de Paris du 11 avril 1720, l'abbaye de Nieul était sécularisée et unie à l'église cathédrale de la Rochelle (1). |
|
|
NOTES: 1) Pouillé du diocèse de Luçon, Aillery. - Poitou-Vendée, Fillon et de Roche brune. - Histoire de l'abbaye de Nieuil, par Arnauld.
|
|
|
|
|
|
L'abbaye de Moreilles, d'abord de l'ordre de Clairveaux, fut bâtie par les seigneurs de Triaize sous l'invocation de la Sainte Vierge. Elle existait avant 1109, puisqu'à cette date Airnery de Bouil, seigneur du Poiroux, ayant fondé dans cette paroisse l'abbaye de Bois-Grolland, fit venir des moines de Moreilles, et mit le nouveau monastère sous la direction et dépendance de la maison-mère, dépendance dont il sut s'affranchir en grande partie dans la suite. Néanmoins l'existence de cette subordination, au moins pendant quelques années, est nettement établie par le document ci-dessous tiré du Cartulaire du Bas-Poitou par Paul Marchegay. Au nom de la sainte et indivisible Trinité, moi, Aimeri de Bouil, voulant bâtir une maison dans laquelle Dieu fut perpétuellement honoré par ses fidèles serviteurs, j'ai plusieurs fois demandé à vénérable homme Méchin, abbé de Moreilles, d'envoyer à Bois-Grolland un certain nombre de religieux et de leur donner un abbé, afin qu'ils y fixent leur résidence, ils y prient constamment le Seigneur pour le pardon de mes péchés et des péchés de mes parents, et enfin pour le bien spirituel de tous les fidèles vivants et trépassés. Le sus dit Méchin, après de longs ajournements, mais toujours sollicité par moi et par beaucoup d'autres, a fini par accorder cette requête. La bulle privilégiée de Lucius II accordée à l'abbaye de Moreilles entre le 12 mars 1144 et le 25 février 1145, lui conféra spécialement la grange ou ferme de Bois-Grolland, qu'Aimery de Bouil avait donnée à la dite abbaye. L'abbaye de Moreille fut, en 1145, visitée par Gilbert de Porte, évêque de Poitiers, et affiliée, en 1152, à l'ordre de Citeaux. Lorsqu'en 1203, l'abbaye de Bois-Grolland quitta la règle de saint Benoît, pour se soumettre à la règle établie à Citeaux; l'affiliation fut faite par Robert, abbé de Bois-Grolland, entre les mains de Maurice, évêque de Poitiers ; mais avec l'assentiment d'Ortensius, abbé de Moreilles. Au mois d'avril de cette même année 1203, l'abbé Ortensius (1) intervint comme témoin, dans un acte de donation faite au profit du prieuré de Saint-Hilaire de Fontenay, par Guillaume Chasseloup et son frère Girard Voussard (2). En 1541, c'est-à-dire trois ans avant de ressortir au siège royal et sénéchaussée de Fontenay, l'abbaye de Moreilles avait pour fermier Joachim Voysin de la Popelinière, près Sainte-Gemme-la-Plaine, père du célèbre capitaine et historien protestant Lancelot Voysin de la Popelinièrel. Ruinée en 1562 par les protestants, et en 1615, parla garnison de Maillezais, des prieurs zélés profitèrent du bon vouloir de Richelieu et de son successeur au siège de Luçon, Aimery de Bragelongne (3), pour reconstruire les lieux incendiés. - Le monastère sembla ressusciter alors, et vit s'augmenter considérablement le nombre de ses religieux (4). L'église, reconstruite en 1699, par les soins du prieur Gédoin, fut bénite la même année par Mgr Charles Frézeau de la Frézelière, évêque de la Rochelle. Au mois de mai 1714, Dom Boyer, savant bénédictin, qui visita l'abbaye de Moreilles et qui y prêcha dit, dans le compte-rendu de son voyage, que l'église de Moreilles était fort belle, et que le prieur, D. Jacques Godel, qui le reçut " avec force amitiés, ainsi que D. Foulon et D. Hébert ", faisait à ce moment-là " bâtir à grande hâte et bien réparer son monastère ", dont l'évêque de Lavaur, Nicolas de Malézieux, était abbé, depuis longtemps. Au moment de la Révolution, il' ne restait plus à Moreilles qu'un seul moine, auquel l'abbé commendataire, qui était l'évê.que de Nancy, faisait une pension sur les vingt-mille livres qui lui restaient. Le 13 février 1790, eut lieu la déclaration de l'abbaye de Moreilles, avec le bail de son revenu de 21.150 livres, affermé sur la caution du directeur général des fermes (5). L'abbaye de Moreilles possédait à Chavigny, un marais, sur lequel les habitants de Nalliers et de l'Isleau avaient pour " coutume ancienne " le droit de mener pacager leurs bestiaux, ainsi qu'il appert d'un acte de 1463. Elle possédait également, dans la paroisse de Bessay, les moulins de la Rochette, deux à eau et un à vent. Ces moulins furent arrentés par l'abbé, en 1703, à Antoine Guignard, moyennant la rente de 200 livres, dont 40 pour le curé de Bessay, et 75 pour l'église du même lieu, consentie par Jean des Forges. L'acte de confirmation est du 6 février 1729 (6). Aujourd'hui, il ne reste plus de la riche abbaye de Moreilles, possédée par M. G..., qu'un vaste enclos, un mur de l'église et des- écuries. |
|
|
NOTES: (1) Le nom du même abbé figure avant 1203, dans un document de la plus haute importance, ayant trait à Chaillé-les-Marais, et que nous regrettons de ne pouvoir reproduire ici. (2) Archives de Fontenay, T. iI page 64. (3) Aimery de Bragelongne, fatigué du fardeau épiscopal, quitta volontairement cette fonction, pour se retirer dans l'abbaye de Moreilles dont il devint abbé.: Il y mourut en 1642. - Un autre abbé de Moreilles, Nicolas de Malézieux, évêque de Lavaur, se trouvait dans son abbaye a la mort de Mgr de Lescure c'est lui qui, le 9 juillet 1723, célébra dans la cathédrale de Luçon, un service solennel à l'intention de son défunt confrère. (4) Lors des obsèques de Mgr, de Nivelle, en 1662, le prieur de Moreilles officiait. Dans l'assistance, se trouvaient Dom François de la Cour, et Dom René Le Geay, moines de la même abbaye. - Boileau, curé de Coussay. - Bruneteau, du Langon, et Grasset, de Petosse. Colbert de Croissy, dans son Etat du Poitou, page 81, prétend qu'en 1666, il n'y avait dans l'abbaye de Moreilles, que cinq religieux non réformés qui, dit-il, vivaient assez bien. -- Le revenu était de 20.000 livres, et le commendataire était Martin de Bragelongne, neveu de l'évêque du même nom. (5) Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée, 1857, page 245, id. 258. Voir Chassin. - La Préparation de la guerre de Vendée, T. I, pages 137-141. (6) Archives du diocèse.
|
|
|
|
|
|
Bois-Grolland (Broqlium ou Boscum Grolandi, et plus souvent Brolium Grollandi), dans la paroisse du Poiroux, était une abbaye dédiée à la Sainte Vierge. Elle avait été fondée en 1109, par Aimery de Bouil, seigneur du Poiroux, et placée sous la règle de saint Benoît. Celle de Citeaux y fut établie plus tard. Le fondateur y fit venir des moines de Moreilles et mit le nouveau monastère sous la direction de sa maison-mère, dépendance dont il sut s'affranchir en grande partie dans la suite. " Au nom de la sainte et indivisible Trinité, moi, Aimery de Bouil, voulant bâtir une maison dans laquelle Dieu fut perpétuellement honoré par ses fidèles serviteurs, j'ai plusieurs fois demandé à vénérable homme Méchin, abbé de Moreilles, d'envoyer un certain nombre de religieux et de leur donner un abbé, afin qu'y fixant leur résidence, ils y prient constamment le Seigneur pour le pardon de mes péchés et des péchés de mes parents, et enfin pour le bien spirituel de tous les fidèles vivants et trépassés. Le susdit Méchin, après de longs ajournements, mais toujours sollicité par moi et par beaucoup d'autres, a fini par accéder à cette requête. " Marchegay. - Cartulaire dit Bas-Poitou. L'église et les bâtiments de Bois-Grolland furent détruits pendant les guerres de religion, puis rétablis par les religieux de l'étroite observance. L'abbaye jouissait d'un revenu de 6.000 livres (1). L'anniversaire de la dédicace de l'église avait lieu tous les ans, le 16 décembre. La charte de fondation. nous apprend que, tout près, il existait alors une forêt du nom de Vertou (Wertaw, c'est-à-dire du silence, lieu tout à fait convenable à des religieux). L'église et le monastère avaient été bâtis dans un goût assez recherché, sous la direction de Dominique .Robin qui, de prieur de Vertou, était devenu prieur et second fondateur de l'abbaye de Bois-Grolland . En 1807, l'abbaye abandonnée était devenue le chef-lieu d'une congrégation . dite- des Ursulines de Bois-Grolland. Elle était composée de religieuses de plusieurs ordres que la guerre avait séparées, et qui s'étaient réunies là pour y vivre de la vie conventuelle. La supérieure était Mlle-de Lézardière. appelée en religion soeur Sainte-Angèle. Cette congrégation fut autorisée par le gouvernement. Sa règle était basée sur celle de saint Augustin. Elle avait une maison à la Roche-sur-Yon, dite de Saint-Gabriel ; d'autres au Poiré-sur-Vie, à Aizenay, aux Sables-d'Olonne, à Tiffauges. La principale mission des Ursulines était l'instruction de la jeunesse et le soin des malades pauvres. En 1813, la mère Sainte-Angèle, sur la demande qui lui en fut faite, et avec la permission de Mgr Paillou, se transporta, ainsi que plusieurs de ses religieuses, dans la ville de Luçon, où elles se réunirent à quelques anciennes Ursulines et s'employèrent à l'éducation des jeunes filles. |
|
|
NOTES: (1) Il avait pour abbé commendataire, en 1666, Mgr de Lingendes, évêque de M con.
|
|
|
|
|
|
L'abbaye de Trizay, dont on voit encore quelques bâtiments dans la commune de Saint-Vincent-Puymaufrais, à peu de distance du Lay, est indiquée dans le Pouillé des bénéfices de France, sous le nom clé Trisagium Trisaium. Placée sous l'invocation de Notre-Dame, elle était fille de l'abbaye de Pontigny, de l'ordre de Citeaux, et eut pour fondateur en 1124, Hervé, seigneur de Mareuil, frère de Guillaume, seigneur d'Apremont. L'ouvrage ci-dessus ne la fait cependant dater que de 1145 (1). Voici, d'un autre côté, en quels termes le Dictionnaire dés familles de l'ancien Poitou parle de cette fondation. " Pierre Achard était, en 1117, présent à la fondation de l'abbaye de Trizay, par Hervé de Mareuil, Geoffroy de Tiffauges qui fut un des bienfaiteurs de cette abbaye, et autres L'auteur du Dictionnaire de la noblesse prétend que c'est seulement en 1124, et sous l'épiscopat de Gilbert, évêque de Poitiers, que Pierre Achard souscrivit l'acte de fondation de cette abbaye. De la déclaration des biens, revenus, etc., fournis le 6 janvier 1790, par le sous-prieur de Trizay (2), il résulte qu'à cette époque, l'abbaye ne comptait plus que cinq religieux, dont la réputation, au dire de certains contemporains, n'était rien moins qu'exemplaire. Dom Le Rouge, religieux de Trizay, a fait imprimer à Fontenay, en 1773, un ouvrage sur l'agriculture, qui a pour titre Principes du cultivateur. Le même religieux est aussi auteur d'un livre qui parut au moment de la Révolution, et qui a pour titre : Voyage aux Pyrénées. |
|
|
NOTES: (1) L'abbé Aillery dit que l'abbatiale de Trizay aurait été bénite-le 15 août 1145. (2) Archives nationales, F 17 1179.
|
|
|
|
|
|
L'abbaye de Breuil-Herbaud, dans la paroisse de Falleron, fut fondée avant 1130, sous l'invocation de Notre-Dame, et soumise à la règle de saint Benoît. Le Dictionnaire des familles du Poitou (art. Thouars) parle d'une confirmation faite en 1029; par Geoffroy, vicomte de Thouars, de la donation en faveur du monastère de Saint-Cyprien de Poitiers, par Raoul Flamme et Raingarde, son épouse, de leur domaine de Breuil-Herbaud, pour y construire un bourg et une église. Cette église, comme son nom l'indique, était située au milieu du bois. En 1680, l'abbé Jacques-Nicolas Beisser, fils d'un chirurgien du Roi, chevalier, commandeur de Saint-Lazare et du MontCarmel, fit rétablir l'église et les bâtiments de l'abbaye , rentrer les domaines usurpés et travailla pour le bien de la maison. Dès l'an 1700 pourtant, il n'y avait plus de moines, et la mense conventuelle avait été unie à la mense abbatiale. Le revenu s'élevait, en 1789, à 6.000 livres, selon les uns, et seulement à 3.000, selon d'autres.
|
|
|
|
|
|
On a prétendu que cette abbaye, située en la paroisse
de Châteauneuf, tirait son nom (insula Galveti) de sa situation
au milieu du marais septentrional, où elle apparaissait comme
chauve et dénuée d'ombrage ; mais il est plus rationnel
d'admettre que le terrain sur lequel elle fut bâtie portait tout
simplement le nom de l'un de ses propriétaires. Ce terrain formait
autrefois une petite île de l'Océan. L'auteur des Ordres
monastiques dit que quelques écrivains assurent que Charles le
Chauve fut le fondateur du monastère qui y fut établi.
Le Gallia Christiana (et nous partageons son avis), croit au contraire
qu'il faut en faire honneur aux moines de l'Absie et aux seigneurs de
la Garnache. Cette fondation aurait dès lors eu lieu seulement
vers l'an 1130. Quoi qu'il en soit, l'île Chauvet était
sous l'invocation de la Sainte Vierge et de l'ordre des Bénédictins,
qui la cédèrent longtemps après aux Camaldules
(1653) (1). L'abbé portait la croix pectorale, la mitre et la
crosse. Les religieux étaient au nombre de sept à huit,
et avaient sous leur dépendance le prieuré régulier
de la Jarrie-Vieille-Seigle, en la paroisse de Landevieille. L'abbé
nommait aussi à trois chapelles régulières desservies
dans l'église, sous les noms de Saint-Julien, Saint-Antoine et
Saint-Sébastien, et à la chapelle de Sainte-Catherine
qui s'y trouvait également. Au moment de la Révolution, le revenu de l'abbaye- de l'île Chauvet était de 4.500 livres (2). |
|
|
NOTES: (1) Louis du Plessis de Richelieu, frère aîné du grand cardinal, mort archevêque de Lyon, en 1653-fut, de 1633 ii 1643, abbé de l'abbaye de File Chauvet. - Un autre abbé, Gaspard de Coligny, abandonna l'état ecclésiastique-pour se marier, en 1681 (Auber). (2) L'abbé Auber donne la date 1670 ; c'est à cette, date
que d'après lui, seraient arrivés à l'île
Chauvet 12 camaldules, appelés par l'abbé Henri de Maupas,
évêque du Puy, et ensuite d'Evreux.
|
|
|
|
|
|
La date de fondation de cet établissement religieux n'est rien moins que certaine, mais on peut croire que cette fondation est due à la terreur qu'inspirait l'approche de l'an mille. Contrairement à l'opinion de Thibaudeau et de l'abbé Aillery (1), qui donnent la date de 1130, on peut affirmer que l'abbaye de la Grainetière existait avant 1100, puisqu'à cette époque, il lui était fait une donation de 45 sols de rente sur la terre do Marigué; par Godefroid, fils d'Alfred, pour le repos de l'âme d'Ozengarde, autrefois épouse de Guillaume Judicaël, seigneur des Herbiers. Quoi qu'il en soit, la premier abbé connu est un Guillaume de Conchamps, également premier abbé de l'abbaye de Fontdoulce, au diocèse de Saintes, fondée vers 1117. Son successeur aurait été Gérald, qui plaça son monastère, de l'ordre de saint Benoît, sous la dépendance de celui de Saint-Michel-en-l'Herm. L'abbaye de la Grainetière, dont il reste encore d'imposantes ruines dans la commune d'Ardelay, était autrefois fortifiée, et en temps de guerre, les habitants du voisinage s'y retiraient. 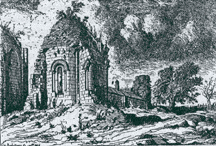 RUINES DE L'ABBAYE DE LA GRAINETIERE D'après une eau-forte de M. de Rochebrune En 1372, les Anglais vinrent assiéger la Grainetière, défendue.. par un vaillant homme de guerre, Martinière, et ne purent s'emparer que de la basse-cour, à laquelle ils mirent le feu. Les religieux avaient même le droit d'établir à la Grainetière un capitaine. Le duc de Berry, comte du Poitou, en nomma cependant sans leur consentement, et leur assigna des gages sur le revenu du monastère. Ces capitaines vendaient et pillaient les biens de l'église, ce qui força les religieux à s'en plaindre à Charles VII qui, ainsi qu'Arthur de Richemond, connétable de France, les avait pris sous sa protection. Le 6 mars 1425, une Commission fut adressée au sénéchal du Poitou, Jean de Torsay, " pour faire enquête et rendre justice à qui de droit " (2). La maison de Chasteigner a possédé longtemps la Grainetière et joui de ses revenus, quoi qu'il y eut des abbés titulaires, dont elle avait fait de simples régisseurs. La mense conventuelle fut unie, en 1760, à la mense abbatiale, sous réserve d'une pension qui se payait au séminaire de Luçon. Cette rente inamortissable était, en 1788, de 2.600 francs, sur laquelle il était payé à Dom Billaud, ancien prieur, une rente de 1.200 francs, plus une pension de 500 francs au desservant de la Grainetière. On accordait aussi 200 francs au curé d'Ardelay, pour aider à la nourriture de son vicaire. Cette abbaye avait alors un revenu de 10.000 livres (3). En 1789, l'évêque de Chartres, dernier abbé, y plaçait un prêtre auquel il donnait 300 francs pour y dire la messe, faire les offices et administrer les sacrements. Disons pour terminer cette courte notice (4) que l'abbaye de la Grainetière eut pour abbé, en 1533, Lazare de Baïf, qui fut tout à fa ' fois maître des requêtes, diplomate, érudit et poète, et que l'abbé Prévost, le gracieux auteur de Manon Lescaul, habita la Grainetière. C'est à l'ombre de ses grands bois, dans ce site à la fois romanesque et sauvage, qu'il composa cet immortel ouvrage qui se répandit dans l'Europe entière pour charmer ses loisirs (5). |
|
|
NOTES: (1) Pouillé du diocèse de Luçon, XXXIII. (2) En 1671, Mgr Nicolas Colbert, évêque de Luçon, visita la Grainetière. - Quatre ans auparavant, dans un rapport au roi, Colbert de Croissy dit que l'abbaye possédée par le sieur de la Roche-Posay (Louis Chasteigner), valait 6.000 livres de rente. (3) l fut un temps où les revenus de la Grainetière étaient évalués à 3.400 hectolitres de grains, sans compter ses autres ressources. (4) Extraite de La Région des Herbiers - Ardelay,
par Louis Brochet.. (5) Lors d'une visite faite le 22 avril 1682, par Mgr de Barillon, il fut constaté que l'abbaye renfermait quatre religieux profès au lieu de six qui existaient précédominent, et qu'ils vivaient à part, ayant chacun des bénéfices particuliers.
|
|
|
|
|
|
Une petite maison religieuse avait d'abord été fondée, en 1172, dans l'île du Pilier ; mais comme la digue naturelle qui la rattachait dit-on, à l'île principale, menaçait peu à peu de disparaître et que les moines étaient ainsi exposés à manquer de toute espèce de provisions, on les transféra à Hério (Noirmoutier). Cette translation a donné lieu à plusieurs appellations qui, quoique différentes, désignent néanmoins le même monastère ... Une fois installée à Hério, l'abbaye prit le nom de Notre-Dame de la Blanche, sans doute à cause de la couleur du costume des moines de Citeaux. En 1205, les seigneurs de la Garnache firent à l'abbaye de la Blanche diverses donations confirmées en 1236, par Pierre de Dreux, duc de Bretagne. Parmi les autres bienfaiteurs de l'abbaye figurèrent Guillaume de Mauléon, Pierre Jobert, de Talmont, Hugues, vicomte de Thouars et seigneur de la Garnache, Aimeri, son fils. Tous ces dons furent approuvés en 1267 par Alphonse, frère de Saint Louis, comte de Poitiers et de Toulouse. Déjà une bulle de Grégoire IX, datée de 1235, avait confirmé toutes les donations faites et à faire. Il avait pris l'abbaye sous sa protection, et lui avait accordée des faveurs spéciales qui rendaient les religieux comme indépendants de la juridiction épiscopale. Il paraît néanmoins que vers l'an 1500, sous l'administration de l'abbé Jean V de la Trémouille, depuis évêque de Poitiers, l'abbaye de la Blanche se trouvait dans un état déplorable, et que l'église était sans ornements, car l'abbé obtint du pape des indulgences pour ceux qui contribueraient à la réparer. Ces indulgences données par le légat, étaient de 1490. L'abbaye de la Blanche éprouva, en 1562, les fureurs des protestants. On lit dans le Gallia Christiana que l'un de ses abbés, Jean VII (1532-1540) "était un loup, sous la peau d'une brebis, et qu'il vaut mieux se taire que d'en parler ".Denis Largentier porta la réforme dans le monastère, en y introduisant des religieux de l'abbaye des Prières (1) au commencement du XVIIe siècle. L'abbaye royale de la Blanche possédait un revenu de 11 à 12.000 livres. |
|
|
NOTES: (1) Abbaye de Bernardins, fondée en 1250, dans le diocèse de Vannes, à l'embouchure de. la Vilaine.
|
|
|
LIEU-DIEU-EN-JARD (Commune de Jard)
|
|
|
Vers la fin du XIIe siècle (1), Richard Ier, roi d'Angleterre, duc de Normandie, comte d'Anjou et de Poitou, fonda l'abbaye de Jard, au milieu d'un bois disparu depuis, et situé sur les bords de la mer. Elle fut placée sous l'invocation de Notre-Dame. Cette maison fut détruite par les Calvinistes le 31 mars 1568. Le 2 avril suivant, un conseil ayant été tenu à Nantes, sous la présidence de l'évêque de Luçon, pour connaître des vexations des protestants, l'abbé Jean de Malins y déclara que le 31 mars de cette même année, le couvent et l'église de Jard avaient été saccagés et brûlés presque entièrement, ainsi que le château de la Grange, demeure ordinaire de l'abbé, et la métairie de la Châtaigneraie, qui faisait là meilleure partie du revenu de l'abbaye. En 1570, René de Sallo, religieux de Jard, devint évêque de Luçon. La mense conventuelle fui, vers 1730, par décret de Mgr de
Bussy-Rabutin, évêque de Luçon, unie au collège
des Prémontrés de Paris, auxquels l'abbaye appartenait
encore en 1755. Les ruines de l'église annoncent qu'elle était considérable. En 1789 le revenu de l'abbaye était de 7.500 livres (2). |
|
|
NOTES: (1) D'aucuns prétendent que c'est en 1208. (2) Colbert de Croissy évaluait, en 1666, à 20.000 livres de rente, l'abbaye de Jard, dont l'abbé commendataire était alors l'évêque de Poitiers (Gilbert de Clérembault).
|
|
|
|
|
|
D'après Thibaudeau dans son histoire du Poitou, l'abbaye d'Angles, de l'ordre des Augustins, aurait été fondée en 1210. 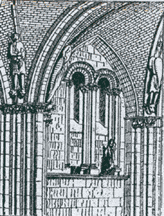 Travée dans l'église d'Angles (D'après une eau-forte de M. de Rochebrune). En 1631, le sénéchal de Fontenay, François Brisson, et Jean Besly, avocat du roi, vinrent visiter l'église et les bâtiments qui avaient été ruinés pendant les guerres de religion. Ils n'y trouvèrent que deux prêtres, qui touchaient les revenus, s'élevant alors à 1.000 livres. Le couvent était rempli d'immondices, et l'abbé n'y résidait point. Le curé seul faisait l'office divin; aussi, pour sa décharge, ob-tint-il, un peu plus tard, en 1671, de Mgr de Colbert, évêque du diocèse, que l'église fut érigée en vicariat perpétuel. Cependant les revenus du monastère étaient encore considérables alors, et la faveur d'être nommé abbé d'Angles était briguée par les plus hautes familles. C'est ainsi qu'en 1704, Jean Pharamond de Sainte-Hermine, ancien lieutenant de vaisseau, devint abbé d'Angles. On voyait ses armes dans l'église du lieu.
|
|
|
|
|
|
L'abbaye des Fontenelles (Fontanelle), commune de Saint-André-d'Ornay, située dans l'ancienne forêt de la Roche-sur-Yon, dont on ne trouve plus que quelques faibles traces, était une abbaye royale de l'ordre des Augustins, qui valait environ 3.600 livres. Elle fut fondée en 1.210 par Guillaume de Mauléon, seigneur de Talmont, et sa femme Béatrix, dame de Machecoul, Luçon et la Roche-sur-Yon. Ces deux personnages et leur fille furent inhumés dans l'église du monastère. Jean de Melun, évêque de Poitiers, avait lui-même consacré l'église en 1248. Les Fontenelles comptèrent parmi leurs bienfaiteurs, Charles, comte d'Alençon et d'Anjou, Jean, duc de Normandie, le connétable de Clisson, René, roi de Jérusalem et de Sicile, tous seigneurs de La Roche-sur-Yon. Le couvent fut d'abord occupé par les religieux de Saint-Benoît, et ensuite par les religieux de Chancelade, dits chanoines de Saint-Augustin. Les Calvinistes massacrèrent, en 1.569, les chanoines, dévastèrent l'église et brûlèrent tous les bâtiments à l'exception des cloîtres. L'abbé Jean Pidoux, oncle maternel du grand fabuliste Jean de la Fontaine, ayant fait reconstruire le dortoir, les protestants y mirent encore le feu plus tard, mais les auteurs de ce second incendie furent contraints, en 1626, de rétablir à leurs frais ce qu'ils avaient détruit. La règle se ressentit de ces troubles :les religieux perdirent de leur ferveur, et Richelieu, évêque de Luçon, crut devoir intervenir en 1614, en leur imposant un règlement sévère. Ces mesures furent cependant insuffisantes ; le désordre fut même poussé si loin, que l'évêque fut obligé; en 1669 (1), d'interposer une seconde fois son autorité d'une manière plus radicale et plus efficace. Il y. appela donc des chanoines réguliers de Sainte-Geneviève, qu'il chargea de réformer les religieux. Il ne restait plus en ce moment aux Fontenelles que quatre moines qui ne méritaient pas d'en porter l'habit et le nom. M. Legrip, dans son histoire des Fontenelles (2), dit qu'à cette époque les moines se livraient au plaisir de la chasse, dans la forêt de La Roche. Ils s'y adonnaient avec une telle passion, qu'il était impossible à certains jours d'en trouver un seul à l'abbaye On les rencontrait aux alentours, le fusil sur l'épaule, vêtus de gris, laissant de côté le scapulaire exigé par les statuts (3). |
|
|
NOTES: (1) En 1666, Colbert de Croissy évaluait à 6.000 livres de revenus l'abbaye des Fontenelles, possédée alors par le fils de Beaumont Pally, gentilhomme, du BasPoitou. (2) Annuaire de la Société d'émulation, année 7874, page 155. (3) La plupart des renseignements- historiques concernant les abbayes dont nous venons de parler, ont été extraits littéralement du Pouillé de Luçon, par l'abbé Aillery.
|
|
|
INFLUENCE DES CROISADES SUR LES FONDATIONS MONASTIQUES
|
|
|
Les dernières abbayes dont nous venons. de faire l'historique n'avaient plus, en général, les dimensions des grands établissements du XIe siècle, où l'importance des créations répondait à de plus grands besoins spirituels, où un plus grand zèle s'était porté vers elles, affirmant sa foi par des couvres grandioses. Ce .sentiment religieux, si développé après l'an mille, avait trouvé à se satisfaire dans l'enthousiasme des Croisades, vers lesquelles .nous verrons les plus puissantes familles bas-poitevines diriger leurs ressources: le besoin d'argent étant devenu plus impérieux que jamais.
|
|
|
L'ÉGLISE ADOPTE LES INSTITUTIONS
ET LES
|
|
|
Depuis 1061, l'abbé, dans les monastères de Luçon, de Saint-Michel et de Maillezais, porte la crosse comme l'évêque, et la crosse est un sceptre temporel, en même temps qu'une houlette pastorale. Comme l'évêque, il exerce une autorité absolue sur les populations urbaines 'et agricoles de ses domaines. Il possède, comme les seigneurs laïques, tous les attributs de la souveraineté, y compris le droit de guerre. L'évêque a sa maison fortifiée dans sa cité épiscopale; l'abbaye est ceinte de murailles et ,,flanquée de tours, et nous verrons Saint-Michel-en-l'Herm résister souvent aux assauts furieux des vicomtes de Thouars et des protestants. Tous deux ont des soldats pour les défendre et de hauts protecteurs pour les aider. Quelquefois, ils chaussent les éperons d'or, revêtent là cotte de mailles, les gantelets de fer, le baudrier militaire, déploient leur bannière seigneuriale pour marcher à la tête de leurs vassaux. Mais les couvents, dont les domaines sont- plus dispersés, sont en général obligés de s'adresser à quelque puis saut seigneur qui. devient leur gardien, leur avoué, leur vidame(1). Le clergé est complètement engagé dans l'engrenage du système féodal. Les évêques, et les abbés ont des vassaux : ils ont des protecteurs ; ils reconnaissent même des suzerains, bien qu'ils ne se soumettent pas à toutes les formalités du pacte féodal, et qu'ils se refusent ordinairement à placer, leurs mains consacrées par l'autel dans les mains d'un souverain laïque. On peut donc dire que l'établissement religieux et le fief sont les deux points auxquels se rattachent, pendant une longue période du passé tous les faits intéressant l'histoire de nos communes rurales (2). |
|
|
NOTES: (1) C'est surtout à, cette époque que s'établit., pour les abbayes, l'usage do prendre pour protecteur, un des principaux seigneurs du pays qui, sous le nom d'avoué (advocatus), devait défendre les biens et les intérêts placés sous son patronage et commander le contingent militaire des terres abbatiales. - Nous avons sous les yeux de nombreuses chartes où des restitutions eurent lieu sur la réclamation des avoués. Nous voyons par exemple que,, sur la réclamation d'Aymeri, vicomte de Thouars et avoué du monastère de Saint-Maixent, devant le comte Ebles et ses optimates, Godebald et Ermembert, restituent à l'abbaye les domaines qu'ils avaient usurpés. Cette charte porte la date de l'an 903 et est signée du comte Ebles, du vicomte. Aymeri, du vicomte Hidegard,. du vicomte Savary et de plusieurs autres. - Charte inédite de lis, collection B, Fillon. (2) Rambaud. - Histoire de la civilisation, T. I, pages ,139. 140 et 141.
|
|
|
DÉVELOPPEMENT DES ÉGLISES DE CAMPAGNE
|
|
|
Beaucoup des églises de la Vendée, établies du vie au XIIe siècle, se sont constituées de la manière suivante. Le fondateur concédait le terrain et faisait bâtir l'édifice par ses paysans (1) ; puis il y installait quelque pauvre clerc à titre de curé, et lui attribuait une partie de la dîme, jusqu'alors payée à l'évêque ou au monastère. Les évêques se plaignaient ils ne voyaient aucune compensation à cette perte, parce que l'usage reconnaissait le fondateur ou ses héritiers comme e patrons " de l'église nouvellement fondée, et les- autorisaient à nommer le curé. L'évêque et les abbés ne jouissaient de ce droit que dans le cas où eux-mêmes étaient les fondateurs, ce qui se produisait souvent pour ces derniers ; ainsi, l'abbé de Luçon nommait à soixante ou quatre-vingts prieurés ou paroisses, celui de Maillezais à vingt-six églises ou prieurés, situés aux diocèses de Saintes, de Poitiers, de Bordeaux, etc. l'abbé de Saint-Michel-en-l'Herm nommait à cent un bénéfices, dont 51 dans le diocèse de Luçon, 32 dans le diocèse de Maillezais, 16 dans celui de Saintes, et 2 dans celui de Mende (2). Il en était ainsi des abbés de Talmont, de Nieuil, etc. |
|
|
NOTES: (1) C'était le cas de l'église de la. Flocelière, .fondée. par un laïque, peu de temps après l'an mille. (2) Louis Brochet. - Histoire de l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm. Pièces annexes, II et III.
|
|
|
LA ROCHE-SUR-YON ET LE POIRÉ-SUR-VIE.
- DROITS
|
|
|
Le prieuré de Saint-Lienne (1), à la Roche-sur-Yon., jouissait de droits considérables, qui lui avaient été accordés par des seigneurs, sous la condition que les religieux entretiendraient dans leur église, des lampes devant le corps de saint Lienne. On conserve. dans les archives de la préfecture de la Vendée, plusieurs chartes originales de donations faites à cette condition: en 1208, par Guillaume de Mauléon en 1218, par Brient de Montaigu; en 1228, par Hervé de Velluire; en 1256 et 1257, par Maurice de Belleville, seigneur de Montaigu et de la Garnache. Aimery de Thouars, seigneur, de la Roche-sur-Yon, donne, en 1218, au prieuré de Saint-Lienne, l'usage dans la forêt de La Roche-sur-Yon, et 60 boisseaux de rente à prendre sur la terre de Château-Fromage, à la condition que l'un des religieux lui servirait de chapelain. Parmi les droits du prieur de Saint-Lienne, se trouvait celui de mettre dans la paroisse du Poiré, un homme clerc et lettré pour tenir les écoles en icelle. Vincent de Pont de Vie, seigneur de Pont de Vie, au Poiré, ayant voulu contester ce droit au prieur de Saint-Lienne, il fut rendu, à Paris, une sentence qui donnait main-levée des empêchements de Vincent de Pont de Vie, et qui maintenait le prieur de Saint-Lienne dans son droit (1). |
|
|
NOTES: (1) Voir à ce sujet la très intéressante brochure de l'abbé Rousseau, aumônier au' lycée de la Roche-sur-Yon. - La Roche-sur-Yon, ses origines. - Saint-Lienne et son prieuré. (2) Thibaudeau. - Notes, T.I, page 448.
|
|
|
USAGE DES BANCS DANS LES ÉGLISES
|
|
|
Anciennement les laïques n'avaient point de bancs dans les églises, pas même dans la nef. On n'y remarquait qu'un siège en maçonnerie, régnant le long des murs des nefs et des transepts, ainsi que les églises du Vieux Pouzauges et des Moutiersles-Mauxfaits en offrent de curieux exemples (1). Plus tard, on se relâcha de cette discipline, en faveur des personnages importants et des seigneurs supérieurs, patrons ou fondateurs. Et enfin, par des concessions successives à l'esprit du temps, l'usage en est devenu général.
|
|
|
PUISSANCE DES ORDRES RELIGIEUX AU XIIe SIÈCLE
|
|
|
La puissance des ordres religieux au XIIe siècle avait permis aux moines de s'attribuer la plus grande et la meilleure partie des fonctions ecclésiastiques. Non seulement les anciens monastères continuent à s'enrichir, comme celui, de Saint-Michel-en-l'Herm par exemple, qui à cotte époque étendait sa domination sur plus de soixante bénéfices, mais il s'en forme sans cesse de nouveaux apportant constamment d'autres stimulants à la, générosité des fidèles. Les abbés relevant du Saint-Siège primaient les évêques dans leur diocèse, et ,ce ne fut qu'après de nombreux, désordres qu'Urbain III obligea, en 1185, les moines à remettre à des prêtres séculiers la direction des paroisses rurales. Alors, mais presque toujours à l'ombre des abbayes, s'élevèrent ces belles églises romanes dont plusieurs sont demeurées à peu près intactes sur divers points de la Vendée. Dans plus de vingt paroisses on peut admirer encore ces façades superbes sur lesquelles l'homme a rendu vivantes ces milliers de statues, ces légions d'anges et de démons, d'hommes et d'animaux qui se dressent à toutes les issues et à toutes les cimes, comme si la pensée ordonatrice de l'œuvre avait voulu en faire l'arche universelle " la grande nef du monde " a dit Henri Martin. |
|
|
NOTES: (1) Lors des fouilles que nous fines exécuter en 1888, dans le ténement des Vieilles-Eglises de Bouillé-Courdault, nous découvrîmes le long du transept de la vieille chapelle du prieuré de Courdault, fondé en 1063, par Airaud et sa femme, des sièges en calcaire, dégrossis, accolés le long des murs.:- Revue du Bas-Poitou.
|
|
|
|
|
|
Pour démontrer combien était irrésistible le mouvement religieux qui, après l'an mille (1), poussait les populations du Bas-Poitou à édifier des établissements monastiques, nous croyons devoir, après avoir fait l'historique des grandes abbayes, donner la nomenclature de quelques prieurés, fondés à peu près à la même époque sur divers points du territoire, en dehors de ceux dont nous avons déjà parlé, notamment, à propos de SaintMichel-en-1'Herm. En 1020, un prieuré relevant de l'abbaye de Saint-Nicolas d'Angers est fondé à Mouchamps. Vers 1040 est fondé, dans la paroisse du Bernard, le prieuré de Fontaines, par un chevalier de Talmont, et donné au monas-tère tourangeau de Marmoutier. Parmi les obligations imposées aux religieux en retour: de cette donation, et outre l'obligation de fournir au prieuré un certain nombre de religieux qui y continuassent des prières pour le seigneur de Talmont et autres, nous voyons une redevance de mille sèches qu'il n'est pas. rare de rencontrer en d'autres chartres du moyen âge. Cet objet était d'autant plus précieux à Marmoutier qu'on ne pouvait se l'y procurer qu'avec beaucoup dé difficultés et 'de grands frais (2). En 1063, Airaud et sa femme fondent le prieuré de Courdault, qu'ils cèdent aux moines de Saint-Cyprien de Poitiers (3). En 1090, Pierre 1er, seigneur de la Garnache fonde, à une lieue de Sallertaine, le monastère` de La Lande-de-Beauchêne, qu'il place sous la direction de l'abbesse de Fontevrault. A la même époque, le prieuré de Saint-Laurent-sur-Sèvre est fondé par les moines de Saint-Cyprien de Poitiers. Ceux de Sigournais et de Puybelliard sont antérieurs à l'an 1090, époque où Bernard, abbé de Marmoutier, près de Tours, vient les visiter. Le prieuré d'Aizenay fut fondé vers 1050, et celui de SaintFlorent-des-Bois avant 1099. Celui de Sainte-Flaive-des-Loups dépendait, avant 1109, de l'abbaye de Montierneuf de Poitiers. Le 6 mars 1190, au moment de partir pour la Terre Sainte, Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre et comte de Poitou, fonde, dans la paroisse de Pissotte, le petit monastère des Gourfailles, et lui concède divers domaines, notamment La Levrière et le fief de la Vitrelle en Pissotte, le moulin de La Roche, la Bonnelle, au-dessous de Haute-Roche, la Touche et le bourg de Sérigné (4). Le prieuré Saint-Nicolas de Fontenay est mentionné dans un acte du 28 novembre 1195, et celui de Saint-Hilaire du même lieu, dans un document du mois d'avril 1203. En 1135, Rainier de Mouchamps et sa femme fondaient, dans la paroisse de Vendrennes, le prieuré de Bois-Goyer. Celui des Epesses était, au XIIe siècle, dépendant de l'abbaye de Vézelay., au diocèse d'Autun. L'aumônerie de Pouzauges était fondée, en 1202, par Guillaume de Chantemerle, seigneur de Pareds. La Vau-Dieu en Vouvent et Champorté de Pouzauges, sont aussi du XIIIe siècle, ainsi que beaucoup d'autres prieurés, dont l'énumération serait trop longue. |
|
|
NOTES: (1) Une note détaillée des donations faites depuis 942 jusqu'en 1154, au prieuré Notre-Dame de Fontenay, dépendant de Luçon, permet de supposer que ce prieuré fut fondé au plus tard dans le premier quart du Xe siècle (Archives de Fontenay, T. I, page 17. (2) Auber M. VII,, page 225. (3) Louis Brochet. - L'ancien prieuré de Courdault. (4) Archives de Fontenay, T. I, page 17.
|
|
|
|
|
|
Par un manque de logique absolu, les seigneurs croyaient trop souvent pouvoir concilier des mœurs déplorables avec les oeuvres les plus éclatantes du zèle chrétien. Vers la fin du XIe siècle, on en était arrivé sur ce point à ne plus avoir d'autres règles que son caprice; les maîtres de la terre disposaient des lois comme d'une villa et d'un arrière-fief ; les règles les plus saintes du pacte social étaient foulées aux pieds, dès lors qu'elles proscrivaient l'injustice et les mauvaises mœurs. Les princes eux-mêmes ne respectaient plus le mariage, et trop souvent le trône de France était souillé de plusieurs adultères. Le peuple, constamment foulé aux pieds, était arrivé à un degré d'abaissement étonnant, car la loi évangélique n'existait plus pour les puissants, et les malheurs auraient été encore plus grands, sans la généreuse intervention de l'Église, qui par ses conciles, par la, trêve de Dieu, par l'action des papes et des évêques, s'interposait souvent entre les bons et les méchants. Le clergé n'échappait pas toujours lui-même à ces désordres croissants. Plusieurs évêques, pourvus de leurs bénéfices par la simonie, résistaient au pape et s'appuyaient sur le roi de France, dont le libertinage soutenait le leur. Des princes aux mœurs déplorables, des cadets de famille, s'asseyaient sur des sièges épiscopaux, sources pour eus de fortunes scandaleuses (1). Les papes étaient souvent nommés par les empereurs d'Allemagne, et la confusion du spirituel et du temporel parut trop souvent complète. En présence de cette situation pleine d'abus et de dangers pour l'église, un moine de Cluny, Hildebrand, devenu depuis pape sous le nom de Grégoire VII, fit décréter par un concile tenu à Rome en 1059, que l'élection des papes serait désormais faite par les cardinaux; c'est ainsi que fut constitué le Sacré Collège. Plusieurs prêtres, dit le savant bénédictin Maunoir, crurent se mettre à couvert des censures canoniques, en prenant des concubines au lieu d'épouses, et l'on vit, jusqu'au milieu du XIVe siècle, des femmes entretenues dans des maisons particulières (2). Les abbés établis pour garder " les murs de Jérusalem ", furent quelquefois les premiers à déserter leur poste, et se répandirent dans le monde, à la cour, y dépensant follement leur temporel. Ce fut alors que les abus et les désordres entrèrent par toutes les portes, et on peut les compter, par les sentences multiples dont les foudroya l'Église (3). L'histoire ne doit certes pas être plus indulgente pour de tels scandales, que ne le fut l'Église elle-même, que rie le furent, les saint Bernard et les Grégoire, mais il ne faudrait cependant pas, confondant l'usage et l'abus, condamner en thèse générale les richesses et le pouvoir temporel du clergé. On peut affirmer, textes en main que le clergé séculier bas-poitevin surtout, dut à son autorité temporelle, de civiliser et d'améliorer notre pays ; de maintenir souvent l'équilibre entre les seigneurs et les vassaux, de protéger le faible contre le puissant, l'opprimé contre l'oppresseur, de frayer à travers ses rangs ouverts à tous une route au plus pauvre et au plus petit, vers les plus grandes destinées. |
|
|
NOTES: (1) Aubert, tome VII, pages 320 et 342. Pitre-Chevalier. - Bretagne ancienne, page 207. Plusieurs conciles se tinrent à ce sujet a Poitiers, notamment l'un en 1078. Un de 1075 défendit sous les peines canoniques les plus graves, de reconnaître la qualité d'évêque ou d'abbé, à quiconque aurait reçu son évêché ou son abbaye des mains d'un laïque.
|
|
|
|
|
|
Bientôt la souveraineté du pape ne s'exerça plus uniquement sur les choses spirituelles, mais aussi sur les choses temporelles. Les papes prirent en main la direction des affaires de l'Europe,. intervinrent au cours des guerres entre les prétendants, proclamèrent la guerre sainte contre les Infidèles, et furent les maîtres incontestés. Le baron cuirassé de fer, les empereurs et les rois, les nations elles-mêmes tremblèrent devant les légats vêtus de rouge, comme tremblaient autrefois les souverains de l'Asie, devant les envoyés du peuple romain. Les seigneurs bas-poitevins n'échappèrent point non plus aux foudres pontificales, non plus qu'aux foudres épiscopales, ainsi que nous le verrons dans un prochain chapitre.
|
|
|
ÉGLISES DES XIe ET XIIe SIÈCLES (1)
|
|
|
Saint-Nicolas-de-Brem. - Porche construit au XIe siècle, avec des débris peut-être carlovingiens.  Crypte de Curzon (D'après une eau-forte de M. de Rochebrune) Cryptes de Notre-Dame de Fontenay et de Curzon. - Même plan par terre, même exécution : quatre colonnes isolées au centre; bancs au pourtour (2) pris dans les premières assises de la construction, - voûte d'arête plein cintre. Cryptes du château de Tiffauges, avec colonnes paraissant remonter à une haute antiquité. Crypte des Essarts, fin du me, - débris de tombeau très
ancien. L'Église abbatiale de Nieuil-sur-l'Autise, l'un des monuments les plus complets et les mieux dessinés qui subsistent dans la Vendée. Le cloître, qui est aujourd'hui la propriété de Mme Sabouraud, est complètement conservé, ainsi que la salle capitulaire dont la voûte a été refaite en 1616, par Pierre Brisson. L'Église de Vouvent, dont nous donnons une vue au chapitre XV, a pu être construite environ dans le même temps quenelle de Nieuil: Foussais. - Le portail seul est conservé : le rez-de-chaussée
bien entendu, car le pignon est du XVe siècle. Sur l'un des deux
grands bas-reliefs encastrés après coup (La Descente de
Croix), on voit cette curieuse inscription :
L'autre bas-relief représente le souper chez Simon, et le Noli me tangere. Maillé et Fontaines sont très altérés dans leurs; façades, dont les sculptures ciselées sur les archivoltes, portent des traces de peinture, ainsi que plusieurs des -parties intérieures de ces monuments. On a trouvé aussi des traces de ces peintures extérieures, à Saint-Michel-le-Cloucq. Belleville. - L'ancienne église de Belleville présente, pour ce qui en reste debout, tous les caractères de l'architecture de la fin du XIIe ou du commencement du Xllle. On y voit encore l'un des plus curieux et des plus rares monuments de l'époque de transition du roman au gothique qu'on ait en Vendée. C'était primitivement la chapelle d'un prieuré de chanoines réguliers de l'ordre de saint Augustin, dépendant de l'abbaye de Nieuil-sur-l'Autise, desservant aussi le château , dans l'enceinte duquel elle était située . Elle devint plus tard l'église paroissiale . - Bâtie probablement par Maurice II de Bellevllle, Seigneur de Montaigu ou par Brient, son successeur. 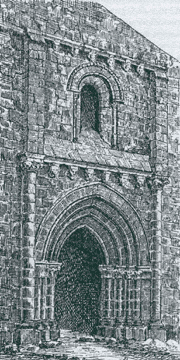 Façade de l'ancienne Eglise de Belleville (Vendée) D'après un dessin de M. Auguste Douillard de Montaigu. Mailtezais, - A l'abbaye, le narthex est du e siècle l'église paroissiale est tout entière du XIIe siècle(3). Chalais. - La chapelle de Chalais, située non loin de Saint-Pierre-le-Vieux, est de la fin du XIe et du commencement du XIIe siècle ; le chevet en est bien conservé, ainsi que les cariatides qui supportent l'entablement, et qui pour la plupart représentent l'emblême de certains vices, ou des personnages dans des postures quelquefois bizarres(4). Benet a sa façade du XIIe (5), mais elle a été renforcée au XVe par des contreforts qui la défigurent. La Chapelle-Giraud, avec ses intéressants bas-reliefs, qui rappellent ceux de Foussais ; Les Moutiers-les-Maux faits et Mareuil-sur-le-Lay, sont trois églises remarquables par leurs nefs intérieures ; celle des Moutiers principalement, dont les trois nefs sont parfaitement conservées, et " sans déformation, tout en granit, donne le type le plus parfait des églises romanes ". - Mareuil offre de belles arcatures dans les murs extérieurs de sa nef et de l'abside. Luçon. - Mentionnons encore le transept de Luçon, qui offre de belles arcatures du XIIe siècle. La Grainetière n'a plus que quelques parties de son abside et de sa salle capitulaire (6), qui font juger de la beauté de son ancienne architecture.. Toute la construction est eu granit, parfaitement appareillée et très bien conçue comme plan. Malheureusement ce superbe débris n'est pas même respecté par la propriétaire actuelle, qui démolit les parements des murs, afin de réparer les maisons de ses fermiers. Dans les environs des Herbiers notamment, il n'est pas rare de voir des chapiteaux employés aux usages les plus divers (7). - A citer encore pour mémoire Saint-Nicolas-de-Brem. Saint-Jean-d'Orbestier, La Caillère, l'arcade du transept de La Chaize-le-Vicomte, etc. 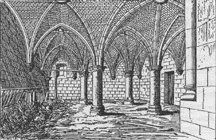 ABBAYE DE LA.GRAINETIERE SALLE CAPITULAIRE |
|
|
NOTES: (1) Les églises se multiplièrent alors avec une profusion d'autant -plus grande qu'un certain nombre de celles qu'on avait édifiées jusque-là, étant construites en bois, avaient été dévorées parle feu ou détruites par les envahisseurs. - C'est aussi du commencement du XIe siècle, c'est-à-dire vers 1030, que date la merveilleuse invention de la musique moderne, par Guy d'Arezzo. (2) Nous en avons également trouvé dans les ruines d'une église romane, sise au ténement de la Vieille-Église de Courdault, dans le canton de Maillezais, ainsi que nous l'avons dit plus haut. (3) Voir le dessin, chapitre ix, page 193. (4) Louis Brochet. - La Vieille Église de Chalais, Vannes,. imprimerie Lafolye, 1890. (5) Voir la photogravure, au chapitre 24. (6) Elle est (lu XIVe siècle, (7) Congrès archéologique. Extrait d'un rapport ce M. de Rochebrune et Recherches personnelles.
|
|
|
CARACTÈRES DES VIEILLES ÉGLISES DU POITOU
|
|
|
En Vendée comme ailleurs, et peut-être plus qu'ailleurs, dit Jules Quicherat, les églises de campagne présentent, dans leur ensemble, l'ouvrage de plusieurs siècles. En généralisant les observations consignées par le regretté M. Léon Audé, il semble que 'la première construction dit plus grand nombre remonte aux approches de l'an 1100 (1). Le plus primitif est celui d'une croix latine formée par un vaisseau unique de cinq travées, par le milieu duquel passe un court transept. Le chevet,. qui est plat, dévie sensiblement hors de l'axe de l'édifice. Ces dispositions ont été altérées au XIVe et au XVe siècle, par l'addition de collatéraux, tantôt à la nef, tantôt au chœur, d'autres fois dans toute la longueur du vaisseau. Au XVe siècle appartiennent aussi des garnitures de mâchicoulis et de breteches construites par dehors pour convertir l'église en forteresse, ainsi que cela se voit encore aujourd'hui au Boupère (2). D'ailleurs, au moyen âge, l'architecture religieuse, en Bas-Poitou surtout, prime généralement toutes les autres : les constructions civiles même, et jusqu'aux édifices militaires, se conforment en plus d'un point, surtout dans l'ornementation, au style adopté par la religion. En effet, le moyen âge est la période religieuse, par excellence, de l'humanité : elle a cumulé l'office de la patrie, de la nation et de la cité : elle règle la vie |
|
|
NOTES: (1) Trois ans après l'an mille, -date assignée par la superstition, b la. fin du monde, un vieil historien, Raoul Glaber, nous apprend qu'il se manifesta dans toutes les Gaules une réaction d'espoir et de joie qui lit sortir de terre des milliers d'églises. Les anciennes furent démolies, quoi, qu'elles pussent servir encore; on avait trouvé mieux. (2) Il convient d'ajouter que des réparations considérables et sans caractère fixe, ont suivi les guerres de religion
|

|

|
| Chapitre Précédent | Table des matières | Chapitre Suivant |